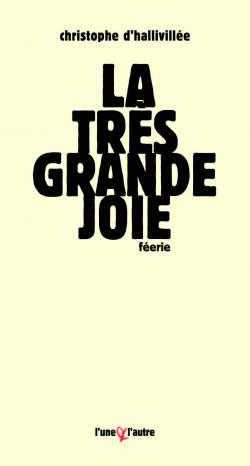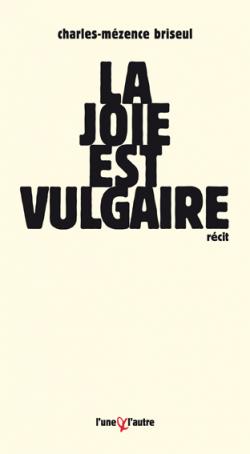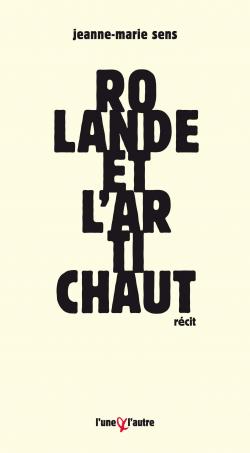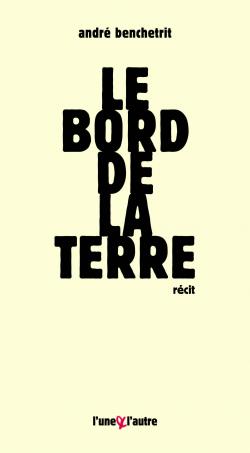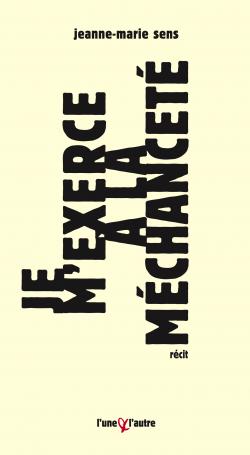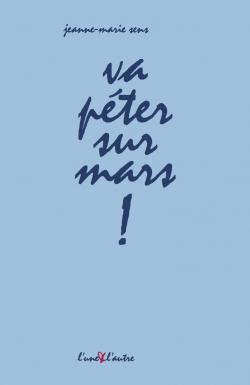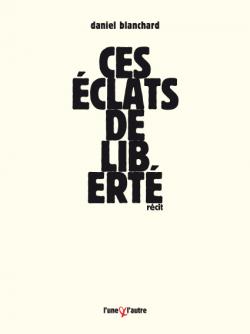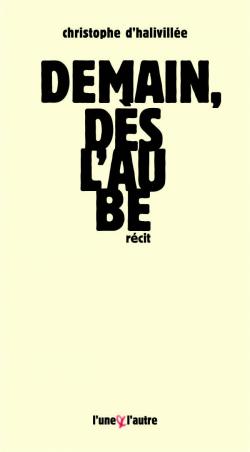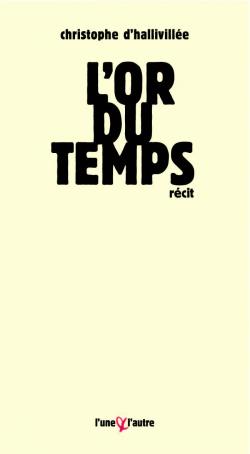Littérature
ROBERT MILIN
“Je ne recherche pas un médium d’élection. Je ne cherche pas non plus une esthétique populaire car je ne veux rien idéaliser à cet égard. Je mets en forme mes projets selon les situations d’interrelation de personnes à un milieu. La forme résulte des situations rencontrées. Certaines œuvres se présentent sous la forme de dessins, d’aquarelles, de photographies, de textes, de vidéos et dans ce dernier cas avec souvent une place importante faite à la dimension sonore. Mes œuvres peuvent aussi prendre l’aspect de sculptures ou d’installations, interagissant avec le contexte. Alors elles modifient ou interpellent le site, assumant toutes les contradictions possibles.” […]
LA TRÈS GRANDE JOIE
“Et vu mon état psychique — à vrai dire assez destroy — c’était pour moi bien difficile d’écrire une nouvelle sur l’identité nationale et l’apologie de la valeur travail, comme le ministre Brice Hortefeux me l’avait ordonné lors du sommet sur l’immigration sponsorisé par BNP/ORANGE/LCL à Vichy, et pour tout dire je faisais un blocage, en fait je ne voulais plus pratiquer ce genre de petit boulot, de surcroît j’étais à bout de nerfs tandis qu’alentour de l’Hôtel du Parc où étaient réunis les ministres de l’Intérieur de l’Union, s’élevaient les clameurs et les explosions de la soi-disant Grande Crise, tandis que partout en Europe et dans le monde les générations cent, deux cents, six cents, huit cents, mille euros avaient en réalité chopé les méga-boules, sans oublier les bannis des DAB, proprios de pavs’ en déroute, sans-retraites, amis des belettes, fonctionnaires en slip, tricksters totaux, déclassés en chute libre, nerds persécutés, rebuts du kapital, illuminés de la sécu, tatoués jusqu’aux cils, geeks de Keno, désœuvrés de la Dalle, petits moineaux des dance floors, forçats de l’interim, claqués de la concurrence, clodos bac+6, anti-pub, exclus du bio...”
LA JOIE EST VULGAIRE
“je salue la vache vénérable, le pissenlit qui est sûrement l’incarnation d’un type bien, hume l’air crade de la ville, passe une main dans mes cheveux huileux, ignore le vagabond qui me casse les pieds sévère, achète ici et là des biscuits fourrés à la crème j’essaie au milieu de la foule de conserver mon identité et ma pleine conscience joyeuse c’est un exercice salutaire et difficile
je suis charles-mézence briseul
je suis charles-mézence briseul
je suis charles-mézence briseul
je suis charles-mézence briseul
je suis charles-mézence briseul
je suis charles-mézence briseul
je suis charles-mézence briseul
premier héros parmi les héros.”
C.-M.B.
ROLANDE ET L'ARTICHAUT
Le rêve et la réalité s’entremêlent, s’ombrent de fantasmes sculptés au cours du temps et l’histoire familiale alors, à l’infini, se recompose et se travestit à la manière du “raconté” accommodé à la mode de chez soi. Sublimée ou diabolisée. Les mots ont gardé les couleurs de l’enfance trahie : Roland(e), dans l’imaginaire de la petite fille, c’est vert et violet. Substitut détesté d’un prénom donné par un homme qui ne voulait qu’un garçon. Amalgame malencontreux, l’artichaut c’est vert et violet. Le duel, un jour ou l’autre, était inévitable entre Rolande et l’artichaut...
LE BORD DE LA TERRE
“Une goule, un bouc, un vampire, un bébé hydrocéphale, une femme squelettique sans bouche, des arbres morts agités de spasmes, un paralytique, des vieilles fées font un bruit épouvantable. Nous les avons vus longer les passerelles, rejoindre la croisée des écoulements. Au milieu de l’île ils gueulent et ils rient, ils donnent des coups de marteau, des montagnes de coups qui roulent, dévalent. Il me dit Papa, c’est un mouvement terrible du bruit, il n’y a pas d’issue, je m’empare du hachoir et j’y vais ! Nous entendons le cri d’une petite fille – un cri déchirant, perçant – comme si quelqu’un s’était emparé d’elle pour la dépecer vive.”
JE M'EXERCE À LA MECHANCETÉ ...
On dit tant de choses des vieux qui, de plus, ont, avec l’allongement de la vie, l’imbécillité de coûter à la société à force de ne pas mourir. Les hommes, passe encore, on leur donne parfois l’avantage d’être beaux, d’avoir une belle gueule, une fière allure encore, ils ne déméritent pas et ont, le cas échéant, quelque privilège d’estime. Les vieilles sont les plus récriées, les adjectifs ne manquent pas, aigries, acerbes, acariâtres, elles ont eu le grand tort de vieillir, de devenir laides, d’avoir des seins affaissés, un ventre flasque à force peut-être d’avoir abrité... Quelques-unes bénéficient du statut flatteur (?) d’avoir de beaux restes, le “restes” en soi est déjà réducteur dès lors qu’il s’agit de restes, de tambouille résiduelle au fond de la casserole, à réchauffer ou à jeter au chat ou au chien... Catégorisés vieux, on oublie dans tout cela qu’ils furent jeunes et ce qu’ils ont donné. J.-M. S.
VA PÊTER SUR MARS !
Jeanne-Marie Sens raconte une histoire autant vécue – la scène a eu lieu et l’endroit est réel quelque part en France – qu’imaginée (les conséquences des attitudes et la responsabilité des jugements ordinaires prononcés au hasard de la quotidienneté). L’histoire est banale, un banc dans un jardin public, des femmes de conditions diverses s’y trouvent, elles s’expriment sur le temps qui passe. L’une d’elles domine, elle a l’éducation et l’argent d’une vie bourgeoise menée avec prudence et responsabilité, une vie courante qu’elle transcende dans le pouvoir de la parole : « elle parle ! » L’auteur a pointé cette situation, utilisant et la narration et la figuration du discours dans l’espace des pages représentant l’envahissement d’une langue dans une situation banale de la domination.
CES ÉCLATS DE LIBERTÉ
Des éclats de cette liberté, que le vingtième siècle s’est acharné à briser comme à raviver, illuminent ou déchirent les quelques personnages de cette chronique dont les histoires se succèdent et se chevauchent depuis les années vingt jusqu’à 1990. Celles de Lucien et de Blanche qui ont traversé les tempêtes des années trente et de la guerre. Celle d’Émile, le narrateur, montagnard déraciné, que la modernité blesse comme une énigme, dont il cherche la solution dans la révolution. Celle du jeune Geoffroy, marqué dès l’enfance par la cruauté de l’époque, qui mène contre elle une guérilla donquichotesque, tout en poursuivant comme un funambule une belle candide et insaisissable. Le récit du narrateur se brise et se renoue au gré de ses sautes de mémoire, des incidents de sa vie présente et de ses tentatives pour comprendre — comprendre l’époque, sa propre vie et ce qu’a vraiment été sa relation avec la femme qui l’a quitté.
DEMAIN, DÈS L'AUBE
“Sur une plate-forme tracée de lignes fluorescentes, une jeune femme apparaît, ombre précaire, dans la lumière des projecteurs. Elle tient des tracts dans ses mains.Tandis qu’elle s’avance vers le vide, les faisceaux strient l’espace. Elle dit: ...”
L'OR DU TEMPS
“Quelques semaines auparavant j’avais reçu par la poste un paquet contenant quatre bobines de films Super 8. Les films avaient été réalisés rue Saint-Jean, au temps où nous étions lycéens.
En les regardant il m’avait semblé que ces images émettaient un signal. Comme des balises de détresse. Guidé par ce signal j’avais accepté le rendez-vous fixé par Paul Bauer.”