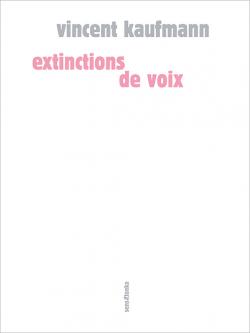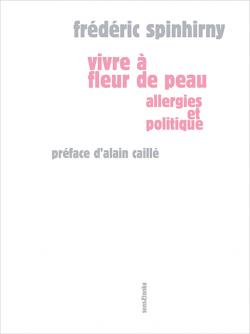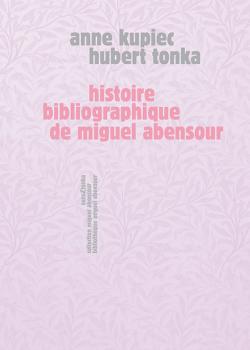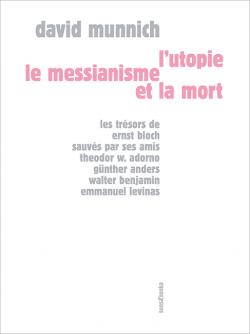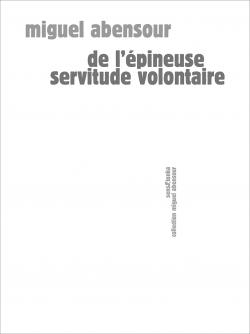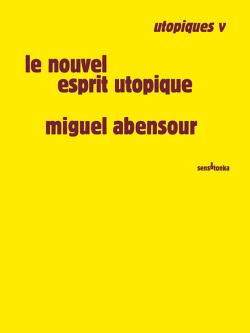Sens & Tonka
Extinctions de voix
À mi-chemin entre récit autobiographique et essai, Extinctions de voix examine le rôle que les médias (les supports de la communication) ont joué, par leur présence comme leur absence, dans la configuration de la vie d’un personnage longiligne, né suisse-alémanique et devenu, Dieu sait pourquoi, un spécialiste de littérature française moderne, alors que celle-ci n’était peut-être pas son genre. Comment ou pourquoi devient-on critique littéraire ? Telle est la question posée dans ce qui s’apparente à une auto-analyse dont le sérieux n’est jamais certain. Le fil conducteur en est l’histoire de la voix de l’auteur ou, plus exactement celle de ses extinctions, de ses défaillances et de ses absences. En effet, si celui-ci a beaucoup rêvé de se faire entendre, il reconnaît volontiers, car le panégyrique n’est pas son fort, qu’il n’avait pas vocation à devenir une voix. Mais n’est-ce pas le destin de tout critique littéraire ? Celui-ci n’est-il pas voué à une voix d’emprunt, à une secondarité qu’il lui arrive de conjurer en se réfugiant dans la théorie ? Ne vient-il pas par définition après ceux qui ont su imposer leur voix, toujours trop tard ? Et comment, si c’est le cas, échapper à la dérision et à l’insignifiance ?
L’ouvrage est constitué d’un prologue, d’un chapitre d’introduction qui en justifie le projet, puis d’une quinzaine de chapitres qui retracent, de la petite enfance à l’âge de la retraite professionnelle, un rapport à la voix, aux automobiles, aux images, aux bandes dessinées, à la télévision, à la radio, aux enregistreurs, au cinéma, au corps et à sa taille, aux mégaphones utilisés dans les manifestations, à l’écriture, aux langues et aux accents, aux (beaux) livres et enfin à la littérature. Il raconte une aventure critique, ou l’aventure d’un critique, placée au sortir de l’enfance sous le signe des années 68, puis de la « théorie », du (post)structuralisme et de l’exil dans le Nouveau Monde, une aventure ponctuée également par la découverte décisive d’auteurs tels que Stéphane Mallarmé ou Guy Debord. Au fil des derniers chapitres, on découvrira que cette aventure est également celle d’une disparition, ou du moins d’un abandon de la critique littéraire, imposés par l’époque, ou par la vie.
Sylvère
Ancien agent de l’édition française à New York, auteur de trois romans et d’une dizaine d’essais, dont French Theory et La Droitisation du monde, François Cusset est professeur d’études américaines à l’Université de Nanterre.
Sylvère, donc !
La vie agitée (1938-2021) d’un presque inconnu, ici juste prénommé, pour servir de tombeau à tout le vingtième siècle : parce qu’il a été enfant caché, habité par la guerre et une judéité refoulée, parce qu’il a pressenti l’éternel retour du fascisme, parce qu’il a importé en Amérique la French Theory et exporté en Europe l’avant-garde US, parce qu’on lui doit une revue culte et des fêtes mémorables, parce qu’il a été l’ami de John Cage et de Félix Guattari, des féministes punks et des artistes en vogue, parce qu’il a été noceur à New York et cinéaste insolite, prof de philo mythique et personnage de série, et qu’il n’a cessé, tout du long, de faire exister plus grand que lui pour se taire et mieux disparaître. Mais le lien compte plus que ceux qu’il relie. Le ventriloque en dit plus que ceux qu’il fait parler. Incarnée par des sensations précises et quelques concepts forts, cette vie-là nous fait voir le crépuscule des modernes, l’intelligence folle d’un monde disparu. Sylvère je l’ai connu, et je voudrais que d’autres, entre les lignes, aient cette chance à leur tour.
à fleur de peau
Préfacé par Alain Caillé.
La distanciation sociale ne date pas de l’épidémie du COVID-19.
Nous nous sommes éloignés les uns des autres comme autant de personnes allergiques. Ce qui nous semblait si familier, nature, animaux, nourriture, et désormais l’autre humain, deviennent des irritations voire des menaces pour notre bien-être et notre identité.
En liant santé publique et politique, développement inquiétant des allergies environnementales et montée préoccupante du rejet de l’altérité, cet essai original analyse les nouvelles intolérances et propose une nécessaire désensibilisation collective.
Vivre à fleur de peau. Allergies et Politique est le quatrième essai de l'auteur publié chez Sens&Tonka, après Éloge de la dépense (2015), L’homme sans politique (2017) et Hôpital et modernité (2018).
le jeu de la trajane
Mort et pouvoir, à Rome, mènent une interminable partie de lettres, qui ne cesse de courir dans les inscriptions des monuments, des fontaines ou des tombeaux.
Des caractères gravés sous la colonne trajane, comme pour perdurer toujours, aux rêves de résurrection des typographes de la Renaissance, des lames de marbre baroques aux serviettes éponges sur les plages asséchées d’Herculanum, le jeu de la trajane poursuit en poésie cette partie perdue d’avance et pourtant toujours gagnée.
CI GÎT POUSSIERE, CENDRE ET NEANT.
Et si jouer avec l’utopie de la lettre, c’était aussi vouloir vivre pleinement de sa mort, pour un vertige toujours recommencé ?
histoire bibliographique de miguel abensour
Nous témoignons, ici, de l’immense travail d’un créateur d’idées, de textes, de commentaires,
qui n’a eu de cesse de développer une intention permanente d’en revenir à l’imprimé, protecteur de tous les détournements.
Auteur et éditeur, Miguel Abensour écrivit et fit des livres sa vie durant.
Il privilégia très souvent la forme de l’essai.
Il s’agit fréquemment de préfaces, de postfaces, de présentations, d’articles et de contributions.
Cette modalité n’est évidemment pas neutre et éclaire la pratique de la pensée de Miguel Abensour.
Ce volume permet de percevoir l’originalité de sa démarche, et de sa pensée bien éloignée de tout conformisme, à l’écart de courants dominants,
constamment articulée à une perspective critique.
De pierre et d’encre
Quelle proximité peut-on repérer entre livre et architecture ?
Il est proposé un chemin sinueux, un recueil d’indices pour tenter d’établir une conjonction. Parole est donnée à des architectes, à ceux et celles qui écrivent des livres. Sont examinées les traces, les expériences, la connaissance issues de cette possible proximité susceptible d’apporter à chacun et à chacune étonnement, ébranlement, estrangement.
l'utopie le messianisme et la mort
Depuis son ouvrage fondateur l’«Esprit de l’utopie» jusqu’au «Principe espérance», et dans la suite des ouvrages de E. Bloch, l’utopie joue pour lui un rôle moteur dans l’histoire humaine pour transformer l’être-devenu et le conduire vers le non-encore-advenu, vers ce qui reste à achever. Si E. Bloch n’a pas réellement fait école, son œuvre a joué un rôle de repère, de recours, d’opposition et parfois de révélateur pour des penseurs et des œuvres très importantes au XXe siècle.
Cet ouvrage porte sur l'utopie de E. Bloch s'appuyant sur ses amis qui dévoilent les trésors contenus par la conception blochienne de l'utopie, donc tout sur les trésors de Ernst Bloch sauvés par ses amis Theodor W. Adorno, Günther Anders, Walter Benjamin, Emmanuel Levinas.
DE L'ÉPINEUSE SERVITUDE VOLONTAIRE
Pour reprendre une belle expression de Pierre Clastres, La Boétie serait-il un "Rimbaud de la pensée" ?
Qu'est-ce à dire, La Boétie, ce tout jeune homme, quand il écrivit Le Discours de la servitude volontaire, il n'avait pas 20 ans, deviendrait-il tel météore génial bouleversant la tradition? Il disparaîtra aussi soudainement qui était apparu, laissa la pensée dominante venir peu à peu occulter la vérité intolérable qu'il avait énoncée dans un moment d'incandescente fulgurance. La Boétie serait l'auteur d'une pensée subversive, scandaleuse. En tant que tel il est une figure d'exception dans l'histoire d'une philosophie politique moderne. À l'inverse de cette interprétation, somme toute rassurante, proposons une contre-thèse selon laquelle l'hypothèse de la servitude volontaire, loin d'être une exception, serait virale, elle ne cesse de hanter la pensée moderne, elle émerge, fait surface, à la faveur d'un événement, d'une grave crise historique, ou d'une controverse politique.
Textes de Miguel Abensour réunis :
Les leçons de la servitude volontaire et leur destin (1976) - Le totalitarisme et la servitude volontaire (2009) - Lettre - préface à L'art de l'amitié (2012)
Spinoza et l'épineuse question de la servitude volontaire (2015) - La Boétie prophète de la liberté (2018).
UTOPIQUE V. LE NOUVEL ESPRIT UTOPIQUE
Au-delà des prémices d’une œuvre à venir, la thèse, dans son économie générale, affiche un “écart absolu” si l’on compare ce texte à ceux précédemment écrits autour de l’utopie.
Miguel Abensour, reprenant la formule de Marx pour qui l’utopie est “l’expression imaginative d’un monde nouveau” ouvrant à l’émancipation humaine et à la “volonté de bonheur”, analyse les écrits, postérieurs à Marx, qui prennent au sérieux ces questions : ceux de Korsch, Labriola, Bloch, Landauer, Benjamin, Marcuse (il convient de noter ici l’intérêt porté par Miguel Abensour à la Théorie critique, alors méconnue en France). Cette analyse le conduit à se pencher sur le communisme critique, “le secret et la vérité des utopies socialistes-communistes” selon la formule de Marx, et à “utopianiser” celui-ci. On perçoit pleinement la novation de la lecture de Marx par Miguel Abensour. Ce qui le mène à aborder la question de l’État laquelle sera largement approfondie dans des écrits futurs.
La série «Utopiques» comporte cinq tomes :
Utopiques I. Le procès des maîtres rêveurs
Utopiques II. L’homme est un animal utopique
Utopiques III. L’utopie de Thomas More à Walter Benjamin
Utopiques IV. L’histoire de l'utopie et le destin de sa critique
Utopiques V. Le Nouvel Esprit utopique.
Le Salon des berces
Pourquoi avons-nous envie de faire une maison ?
Pourquoi avons-nous envie de l’entourer d’un jardin ?
”Comment imagine-t-on une maison ? Par quoi commence-t-on ? Existe-t-il une pièce plus importante que les autres ? Celui qui n’a jamais pratiqué l’exercice ne sait pas combien ces questions, exemplaires de trivialité, atteignent le fond de la conscience en malmenant nos habitudes puisque, soudain, elles interrogent leur bien-fondé.” (G. C.)
La maison est dans une vallée (des papillons), aujourd’hui La Vallée... Comment vit une maison sur un bout de planète de nature ? Elle la transforme en jardin qui devient pour le jardinier-maçon, puis créateur & savant, un lieu d’observation, d’action et d’expression, vie quotidienne et théorie, qui permettent d’appréhender les questions qui se posent, de comprendre ce qui se passe dans le Monde.
Gilles Clément raconte les péripéties sociales, les actions du corps et comment les idées viennent à l’humain et comment, et pourquoi cette espèce fait partie et rencontre toutes les autres et les plantes qui permettent le vivant, la vie.