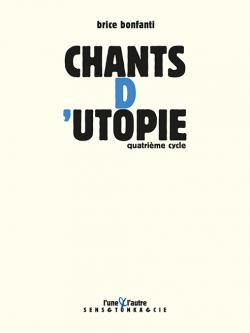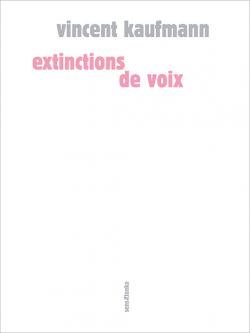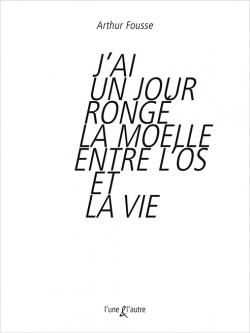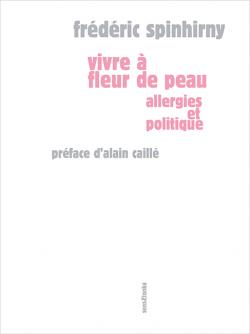sens & tonka & cie
est une maison d’édition française regroupant deux marques :
SENS & TONKA, ÉDITEURS, qui se consacre aux sciences sociales.
Chant d’utopie
Imaginée en 2001, l’écriture des Chants d’utopie commencée continue.
Ces minuscules épopées en prose et vers, ou prose ou vers, cherchent toujours une étincelle qui annule les ténèbres, ce qui, sans lieu, irrigue tous les lieux, l’utopie !
Neuf cycles de neuf chants sont annoncés. Trois premiers cycles ont paru.
Voici le quatrième.
La suite donc – mais une mer l'a changée. Après une décennie et demie au pied des monts retour occitan à Notre Mer méditerranéenne.
Les chants qui y sont nés sont nés marins, poissonneux, salins. Ainsi le chant du Sahara, et même le chant d’Iraq. On ne sait pas ce qui se trame, dans Notre Mer.
La poésie de Notre Mer est dégagée, embrasse les contraires, vus, sus et lus, complémentaires, dans la mer à ressac et à sac.
Dans ce cycle nouveau, on lira les effets de cette reformulation marine du terrain, des champs d’utopie, de ses prairies.
On croisera l’épique affrontement au Pérou des enfants paysans Micaela et Túpac contre un nécrotératoplasme extraterrestre aussi terrorisant que dégoûtant. Depuis le pays Dogon, l’exploration en cosmonef d’exoplanètes par une grande mère, Innekuzu, dont la vieillesse remonte en jeunesse. La musique néoplatonicienne d’Hypatia d’Alexandrie, hors mélodrames moraleriserinés et sentimentalinassés des hominidés. L’amour interne à toutes et au-delà de toutes religions, proclamé doucement par Kabîr, tisserand à Vārānasī. La tranquillité totale, engagée dans le dégagement total, des moines sangliers, singuliers frères d'Athanase au mont Athos, au milieu du déluge mondial en fin de cycle. Le paradis du jardin perse, dans l’Iran, des enfants de Zarathoustra, légers comme un babil de la première langue. La nuit érotique et alchimique de Zosimos et Myriam à Panopolis. L’action invisible des poissons sarhaouis sur la main de Meriem au Sahara, désert fait mer. La flamme folle amoureuse de Rabi’a en Iraq.
Et toutes ces figures du divers ethnosphérique, le divers salutaire des ethnies toilant la sphère, issues de notre histoire, découvrent hors du temps l’Or du temps, se trouvent toutes dans leur Utopie qui est à tous et à personne.
Sylvère
Ancien agent de l’édition française à New York, auteur de trois romans et d’une dizaine d’essais, dont French Theory et La Droitisation du monde, François Cusset est professeur d’études américaines à l’Université de Nanterre.
Sylvère, donc !
La vie agitée (1938-2021) d’un presque inconnu, ici juste prénommé, pour servir de tombeau à tout le vingtième siècle : parce qu’il a été enfant caché, habité par la guerre et une judéité refoulée, parce qu’il a pressenti l’éternel retour du fascisme, parce qu’il a importé en Amérique la French Theory et exporté en Europe l’avant-garde US, parce qu’on lui doit une revue culte et des fêtes mémorables, parce qu’il a été l’ami de John Cage et de Félix Guattari, des féministes punks et des artistes en vogue, parce qu’il a été noceur à New York et cinéaste insolite, prof de philo mythique et personnage de série, et qu’il n’a cessé, tout du long, de faire exister plus grand que lui pour se taire et mieux disparaître. Mais le lien compte plus que ceux qu’il relie. Le ventriloque en dit plus que ceux qu’il fait parler. Incarnée par des sensations précises et quelques concepts forts, cette vie-là nous fait voir le crépuscule des modernes, l’intelligence folle d’un monde disparu. Sylvère je l’ai connu, et je voudrais que d’autres, entre les lignes, aient cette chance à leur tour.
Extinctions de voix
À mi-chemin entre récit autobiographique et essai, Extinctions de voix examine le rôle que les médias (les supports de la communication) ont joué, par leur présence comme leur absence, dans la configuration de la vie d’un personnage longiligne, né suisse-alémanique et devenu, Dieu sait pourquoi, un spécialiste de littérature française moderne, alors que celle-ci n’était peut-être pas son genre. Comment ou pourquoi devient-on critique littéraire ? Telle est la question posée dans ce qui s’apparente à une auto-analyse dont le sérieux n’est jamais certain. Le fil conducteur en est l’histoire de la voix de l’auteur ou, plus exactement celle de ses extinctions, de ses défaillances et de ses absences. En effet, si celui-ci a beaucoup rêvé de se faire entendre, il reconnaît volontiers, car le panégyrique n’est pas son fort, qu’il n’avait pas vocation à devenir une voix. Mais n’est-ce pas le destin de tout critique littéraire ? Celui-ci n’est-il pas voué à une voix d’emprunt, à une secondarité qu’il lui arrive de conjurer en se réfugiant dans la théorie ? Ne vient-il pas par définition après ceux qui ont su imposer leur voix, toujours trop tard ? Et comment, si c’est le cas, échapper à la dérision et à l’insignifiance ?
L’ouvrage est constitué d’un prologue, d’un chapitre d’introduction qui en justifie le projet, puis d’une quinzaine de chapitres qui retracent, de la petite enfance à l’âge de la retraite professionnelle, un rapport à la voix, aux automobiles, aux images, aux bandes dessinées, à la télévision, à la radio, aux enregistreurs, au cinéma, au corps et à sa taille, aux mégaphones utilisés dans les manifestations, à l’écriture, aux langues et aux accents, aux (beaux) livres et enfin à la littérature. Il raconte une aventure critique, ou l’aventure d’un critique, placée au sortir de l’enfance sous le signe des années 68, puis de la « théorie », du (post)structuralisme et de l’exil dans le Nouveau Monde, une aventure ponctuée également par la découverte décisive d’auteurs tels que Stéphane Mallarmé ou Guy Debord. Au fil des derniers chapitres, on découvrira que cette aventure est également celle d’une disparition, ou du moins d’un abandon de la critique littéraire, imposés par l’époque, ou par la vie.
J’ai un jour rongé la moelle entre l’os et la vie
Le texte se présente comme un oratorio imprécatoire. D’un style à l’éloquence invocatoire aux engagements sataniques dans son propos, il engage un chemin dans la parole excessive, impraticable autour de Francis Bacon. Il s’affirme comme un texte « précaire » : une prière au sens latin, qui a vocation à agir comme une offrande mystique dans un cadre rituel, celui de l’élocution poétique : celle de la perte du langage dans la langue, de la perte de la langue dans la voix. La ritualisation prophétisée à l’excès dans une prosodie rythmée jusqu’à l’hallucinatoire, revendique une filiation entre l’engagement mythique des Aztèques pour le sacrifice humain et la réhabilitation du 5e soleil, marquant la fin apocalyptique de la régénération cosmique. Francis Bacon, institution apocalyptique, joue comme soleil à l’époque contemporaine. Francis Bacon s’avère le seul à pouvoir traduire et manifester le sens extrême d’une telle précaution rituelle et oratoire, sans faire tourner la ritualisation à un exutoire superficiel. Le texte restaure l’ambivalence de l’extorsion du cœur à l’esclave qu’est l’auteur, qui est, aussi, le Maître du sacrifice une soustraction incessante de la Parole au mot. Il engage un sens forcené, une vision qui s’avère ésotérique, permettant de rendre la violence de la parole au langage.
à fleur de peau
Préfacé par Alain Caillé.
La distanciation sociale ne date pas de l’épidémie du COVID-19.
Nous nous sommes éloignés les uns des autres comme autant de personnes allergiques. Ce qui nous semblait si familier, nature, animaux, nourriture, et désormais l’autre humain, deviennent des irritations voire des menaces pour notre bien-être et notre identité.
En liant santé publique et politique, développement inquiétant des allergies environnementales et montée préoccupante du rejet de l’altérité, cet essai original analyse les nouvelles intolérances et propose une nécessaire désensibilisation collective.
Vivre à fleur de peau. Allergies et Politique est le quatrième essai de l'auteur publié chez Sens&Tonka, après Éloge de la dépense (2015), L’homme sans politique (2017) et Hôpital et modernité (2018).
Têtes de bois
PHOTOGRAPHIES
Paysage, beauté, grandeur et liberté, bois et forêts entourés de plaines solitaires,
plantations diverses, selon le lieu et le climat, parures de villes et de villages.
Atmosphère...
- Ils sont beaux quand on leur permet de respirer et d'exister -
le jeu de la trajane
Mort et pouvoir, à Rome, mènent une interminable partie de lettres, qui ne cesse de courir dans les inscriptions des monuments, des fontaines ou des tombeaux.
Des caractères gravés sous la colonne trajane, comme pour perdurer toujours, aux rêves de résurrection des typographes de la Renaissance, des lames de marbre baroques aux serviettes éponges sur les plages asséchées d’Herculanum, le jeu de la trajane poursuit en poésie cette partie perdue d’avance et pourtant toujours gagnée.
CI GÎT POUSSIERE, CENDRE ET NEANT.
Et si jouer avec l’utopie de la lettre, c’était aussi vouloir vivre pleinement de sa mort, pour un vertige toujours recommencé ?
dédales aux cloisons d'air et de temps
L’exercice de l’autobiographie comporte une limite fatale :
il lui manquera toujours le dernier chapitre, la page ultime, l’épilogue que son auteur n’aura pu écrire.
Prenant acte de ce manque structurant non moins que structurel, l’auteur de Dédale aux cloisons d’air et de temps
a tenté de le pallier en dressant en quelque sorte un État des lieux à l’instant où prend fin son récit, ouvrant ainsi en guise de conclusion
une parenthèse que rien ne viendra refermer.